
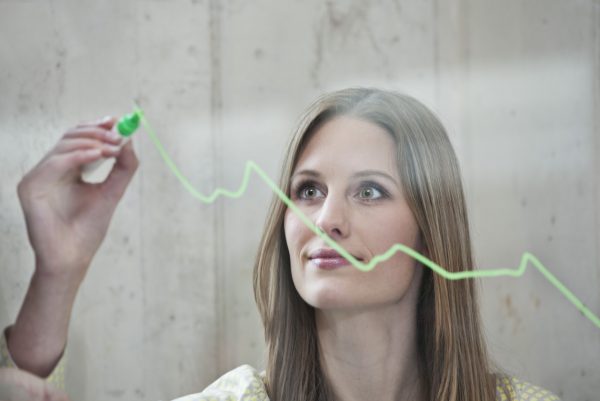
news société
Dépassement de soi: jusqu’où ira le diktat de la performance?

Des larmes, de la sueur, parfois les cris de douleur qui vont avec. Ce triptyque vous évoque vaguement une scène de torture, voire de l’enfer? On n’en est pas très loin. Sauf que cela se déroule sur terre, en 2016: sur les réseaux sociaux, en salle de sport, au travail ou à la télévision. Et que, pour n’avoir rien de médiéval, les supplices en question n’en apportent pas moins leur dose de souffrance. Qu’ils prennent la forme de gainage du corps, de défis périlleux face caméra ou d’explosion de ses résultats personnels au bureau.
De tous côtés, en effet, les actes individuels visant le dépassement de soi et la performance nous envahissent. Après des années d’introspection douce et de développement de soi, mode méditation et posture du lotus devant sa fenêtre, l’ère est plutôt à l’effort intense, histoire d’aller voir là-bas, au-delà de nous-même, si on y est. Il suffit ainsi de se pencher sur les chiffres de l’industrie du fitness. En 2013, près de 700 000 Suisses étaient inscrits dans un club, selon une étude menée par Planet Fitness. Fin 2015, ils étaient 100 000 de plus. Avec, à la clé, des salles qui ouvrent presque à chaque coin de rue, où résonnent des mantras guerriers. «Choquer son métabolisme» et «sortir de sa zone de confort» pour remodeler sa silhouette avant l’été: l’ambiance caserne n’est pas loin.
Devenir un autre
Sur internet, des volées de hashtags témoignent du phénomène. Ainsi de #NoPainNoGain, #NeverGiveUp ou #NoExcuses. «Les résultats commencent à se voir, mais la route est encore longue», énoncent ici ou là des internautes dont le corps est pourtant taillé comme celui d’une divinité grecque. Leur objectif: aller toujours plus loin. Parce que la normalité ne suffit plus. «Aller au-delà de ses limites, certes. Le problème, c’est que les gens ne les ont jamais expérimentées, ces limites. Or comment peut-on dépasser quelque chose qu’on ne connaît pas?», s’interroge Denis Hauw, professeur de psychologie du sport à l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (UNIL). C’est pourtant cette inconnue qui excite l’imaginaire de l’individu lambda. Le dépassement de soi résonne comme la promesse de devenir quelqu’un d’autre, quelqu’un de plus performant. «Nous vivons dans un monde où tout est contrôlé et verrouillé, où on ne peut pas passer à la marge, poursuit Denis Hauw. Cette envie de dépassement de soi est une forme de réaction à ces contraintes permanentes qui pèsent, au sens premier du terme, sur l’individu, et qui l’empêchent de se développer.»
Quantifier et comparer
Parmi ces forces plus ou moins discrètes qui s’exercent sur nous, il y a bien sûr la fameuse compétition sociale. Celle qui fait se confronter les performances des uns avec celles des autres. Prétendument engagée contre soi-même, la course cathartique qui vise à découvrir cet autre moi sommeillant en chacun a surtout besoin des autres pour savoir ce qu’il faut dépasser. Pour se jauger, rien de tel que les statistiques calculées en direct par toutes sortes d’objets connectés qui peuplent désormais notre quotidien. Téléphone portable ou montre «smart», ils sont devenus nos entraîneurs personnels.
Mouvement lancé en 2007 en Californie par deux éditeurs du magazine «Wired», le quantified self (QS) ou quantification de soi, illustre bien le phénomène. En récoltant des données chiffrées sur son corps à l’aide de capteurs intégrés sur un bracelet (donnant l’heure ou non), ou plus simplement par le biais d’applications installées sur son smartphone, le QS vise à obtenir des données numériques permettant à chaque utilisateur de dresser un graphique évolutif de ses performances. De s’évaluer par rapport aux autres, de se fixer des objectifs en se dépassant. Le but: pulvériser ses propres résultats.
Clairement, ici, la référence est le sportif d’élite, héros contemporain qui, en se surpassant, s’élève en dessus de la masse. Une sorte d’Hercule mythologique de tous les jours, accomplissant l’extraordinaire auquel nous aspirons tous. La spectacularisation du sport, qui réclame toujours plus de performance, finit de nourrir l’idée que le champion est un modèle à imiter ou, du moins, à suivre. Le moindre geste devient alors une compétition épique visant à rehausser notre position dans la société.
Plus que parfait
Les tapis de sol, les cimes des montagnes, oui… Mais, au quotidien, le lieu par excellence où s’exprime cette tendance, c’est le travail. «Nous sommes constamment en concurrence, explique Gianni Haver, sociologue de l’image et professeur à l’UNIL. Quand je vois sur Facebook que ma photo n’obtient que cinq like alors que celle de mon voisin en a vingt-cinq. Lorsque sur mon tapis de course je fais du 12 km/h alors qu’à côté l’autre en affiche 8. Et bien sûr, quand mon collègue réalise un chiffre d’affaires supérieur au mien.» Dans le milieu professionnel comme sur les tapis roulants, les évolutions vers davantage d’effort sont flagrantes. «Tout est évalué dans une logique qui autrefois était celle de pays comme la Chine – où on affichait le portrait de l’employé le plus productif du mois, relève le sociologue. On est dans cette idée de podium: on a transporté une logique de sportivité dans l’univers du travail.» Dès lors, être satisfaisant aux yeux des autres, remplir ses objectifs, n’a plus tellement à voir avec le fait de réaliser les tâches confiées. «La vraie mesure, c’est l’autre. Il faut être meilleur que lui.»
Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que l’on adopte collectivement cette mentalité de joueur olympique à plein temps? «La douche froide que furent les crises des années 90 a lavé le cerveau de toute une génération, note Gianni Haver. Elle a engendré l’idée que pour obtenir un job à peu près satisfaisant il fallait entrer en concurrence avec les autres, faire mieux qu’eux.» L’optimisme des Trente Glorieuses a fait place au pessimisme des Trente Piteuses. «Dans les années 70 et 80, l’absence de crise économique permettait aux gens de se dire que, de toute façon, il y aurait toujours un moyen de s’en sortir, qu’il fallait faire ce qu’on aimait. Aujourd’hui, on ne pense pas que les choses vont aller mieux mais que, demain, ce sera pire!»
A lire aussi:
Le Net, notre usine à gossips
Quitter son job, c’est bon pour le moral!
Sport: 6 courses un peu folles
Dans un contexte à ce point morose, se surpasser sans sourciller est peut-être le seul antidote que nous ayons trouvé au fataliste «c’était mieux avant».
Pis: même là où devraient primer divertissement et coolitude, l’injection à la performance s’est invitée dans la photo. La télé-réalité, par exemple, est elle aussi marquée par cette idée de dépassement de soi. Dans «Koh Lanta», «The Island», «Top Chef» ou «Les reines du shopping», les candidats «donnent tout et ne lâchent rien», dixit les voix off survoltées. La mise en scène a en effet évolué de l’immobilisme façon «Loft Story» à une perpétuelle compétition dans laquelle on court, on sue et on grimace. «L’époque des émissions de télé-réalité où, pour gagner de l’argent, il suffisait de se laisser filmer à ne rien faire est révolue, explique François Jost, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle et théoricien de la télévision. Aujourd’hui, le modèle est celui de la compétition: il faut être le meilleur, payer de sa personne, avoir lutté pour mériter d’être le vainqueur et toucher le pactole.» La morale performeuse s’est en quelque sorte infiltrée dans ces programmes: «Il est intéressant de noter que les émissions de télé-réalité sont souvent originaires de pays protestants où le travail est la valeur cardinale et où l’oisiveté des loisirs est souvent considérée comme un signe de manque de réussite.»
Nos esprits façonnés
Alors, tous condamnés à nous décarcasser et à regarder les autres faire de même, jusqu’à basculer dans un état d’esprit – voire dans une tyrannie – sadomaso? «A notre insu, les valeurs véhiculées par ces images et ces programmes pénètrent notre cerveau et vont jouer sur nos comportements sociaux», explique le professeur et chercheur en sciences de l’information et de la communication Didier Courbet dans la revue «Communication» de l’Université Laval (Québec). Et cela malgré la nature apparemment divertissante de la télé-réalité. «C’est précisément lorsqu’on est dans le domaine de l’amusement que nos défenses cognitives sont les plus basses. Face à un débat politique, par exemple, notre esprit critique est en éveil. C’est moins le cas lorsqu’on regarde un divertissement. Or les valeurs s’ancrent d’autant plus efficacement qu’elles se transmettent inconsciemment.»
Il y a, enfin, un paradoxe dans le fait que le dépassement de soi vise à l’épanouissement de l’individu, mais qu’à peine le haut fait accompli, la limite dépassée... tout est à recommencer. «Cette logique est frustrante a priori, analyse Gianni Haver. Car une fois qu’on s’est surpassé, comment se maintenir? Combien de temps avant que s’impose la nécessité de repousser encore plus loin ses limites pour rester meilleur que l’autre? Les cas de dépression et de burn-out, maladies modernes qui n’existaient pas auparavant, viennent clairement de ce type de fonctionnement.» Tomber, se relever. Repartir au combat. Et ainsi de suite. A l’infini. L’humanité contemporaine aurait-elle pris Sisyphe pour modèle?
Lindsey Vonn, même pas mal
On se souvient de cette vidéo du drainage du genou de la skieuse Lindsey Vonn. Une séquence qui mettait en scène sa résistance élevée à la douleur. «Quand on regarde les grands sportifs, on a parfois l’impression qu’ils ne souffrent pas, commente Denis Hauw. Mais ça, c’est de la communication! Les sportifs d’élite sont aussi des objets de marketing qui portent les messages de leurs sponsors. Ils ne peuvent pas flancher. Même lorsqu’ils sont blessés, ils montrent qu’ils vont revenir. A l’image de l’Américaine, qui laisse entendre que sa ponction n’est qu’une simple formalité. «Il ne faut pas pour autant sous-estimer leur résistance à la douleur. On n’atteint pas leur niveau sans avoir appris à supporter une dose conséquente et régulière de souffrance. Les grands sportifs atteignent le niveau élite lorsqu’ils ont passé plus de dix mille heures de pratique. De quoi forger le corps et le mental tout en intégrant la culture de la contrainte.»
Accro au dépassement de soi
Lorsqu’on vise l’au-delà de ses limites, les comportements addictifs ne sont jamais loin. «Les gens ont parfois cette pulsion du dépassement de soi, détaille Denis Hauw. Cette énergie vécue, ressentie par eux, est liée à l’image qu’ils ont de leur corps. Or l’image de soi se construit tout au long du développement de la personne. Elle constitue le support identitaire. Et à certaines périodes de la vie, cette identité corporelle est fragilisée.» Notamment durant l’adolescence, lorsque les jeunes grandissent et ne savent pas toujours très bien dans quel corps ils habitent. Ou lorsqu’on prend de l’âge. «La pulsion du dépassement de soi peut alors se manifester de deux façons différentes. En s’épuisant par de l’exercice à outrance pour ne plus entendre ce corps qui change et perturbe notre équilibre. Ou en façonnant, en sculptant son physique, pour mieux le contrôler.»

